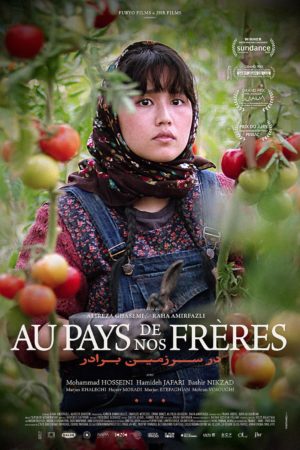« Le cinéma aujourd’hui est-il iranien ? »
J.M.G. Le Clézio, Ballaciner, Gallimard, 2007, p. 134
Palme d’or à Cannes avec Le Goût de la Cerise d’Abbas Kiarostami en 1997, Lion d’Or à Venise avec Le Cercle de Jafar Panahi en 2000, Ours d’Or à Berlin avec Une Séparation d’Asghar Farhadi en 2011, le cinéma iranien a remporté en quelques années les plus prestigieux prix internationaux devenant une référence pour de nombreux cinéastes à travers le monde. Comment expliquer un tel succès ? L’Histoire du cinéma iranien est complexe, à la fois précoce et tardive, faites de ruptures et de continuités, il témoigne des transformations d’un pays sur plus d’un siècle. D’un art de cour sous la dynastie des Qadjar, le cinéma iranien ne devient un art de masse qu’à la fin du muet à travers une série de films tournés principalement en Inde. Il faut en effet attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que l’Iran se dote d’une industrie cinématographique. La production est alors dominée par des films commerciaux : les films farsis, terme péjoratif qui résonne avec les films indis de l’Inde et désigne un cinéma commercial aux recettes éculées enchaînant les scènes de danse, de chant, de dispute et de romance. Un « cinéma différent », le « Cinéma Motefavet », se met toutefois en place dans les années 60. Cette « Nouvelle Vague iranienne » annonce celle qui suivra la Révolution. Deux réalisateurs dominent le cinéma postrévolutionnaire : Abbas Kiarostami et Mohsen Makhmalbaf. Leurs oeuvres se composent de films sur l’enfance, de récits tournés dans des provinces éloignées, de mises en abyme de la fiction et du documentaire au risque d’une certaine répétition.Un tournant est pris dans les années 2000 à travers des films plus sociaux aux préoccupations plus concrètes. On assiste par ailleurs à la naissance d’un cinéma iranien de la diaspora avec Persepolis de Marjane Satrapi. Le cinéma iranien ne se limite plus à une esthétique ni à un réalisateur. C’est pour rendre compte de sa richesse et de sa diversité qu’il nous faut retracer son Histoire.
Prémisses et premiers films
Le cinéma iranien naît officiellement en 1900 lors d’un voyage en Europe de Mozzafareddine Shah, souverain Qadjar. Grand amateur de photographie, il achète une caméra Gaumont qu’il confie à Mirza Ebrahim Khan Akasbashi. Le premier film iranien est tourné à Ostende le 18 août 1900 lors de la Fête des Fleurs.
Ce premier opus est à l’image de ceux qui suivront. En effet, l’art cinématographique reste un art de cour en Iran jusqu’à la fin de la dynastie Qadjar. Quelques salles ouvrent mais doivent rapidement fermer. Ce sont deux Américains : Ernest Shoedsak et Merian Cooper, les futurs réalisateurs de King Kong (1933), qui signent le premier long métrage sur le sol iranien : Grass (1924), un documentaire ethnologique qui s’intéresse à la migration de la tribu des Bakhtiari dans le sud-ouest de l’Iran.
Au début des années 30 sort le premier film de fiction iranien : Abi et Rabi (1931) d’Avanes Ohanian, réalisateur arménien ayant fui la Révolution russe. Ce long métrage aujourd’hui disparu est conçu sur le modèle des comédies burlesques de l’époque. C’est au même réalisateur que l’on doit Hadji Agha, acteur de cinéma (1934) qui en utilisant le principe de la mise en abyme essaye de réconcilier le cinéma avec le peuple et les religieux. Par bien des aspects, le film rappelle La Vendeuse de cigarettes du Mosselprom de Youri Jeliaboujski, comédie soviétique de 1924 dont l’action impliquait un tournage en extérieur et une réflexion sur le cinéma et ses sortilèges.
Ces films correspondent à un changement de dynastie comme le montre La Fille de la tribu de Lor (1933) d’Ardéshir Irani, premier film parlant à la gloire de Téhéran et de la politique de pacification des provinces menée par le nouveau souverain, Reza Pahlavi. Le film conte une histoire d’amour entre le jeune administrateur : Jaffar interprété par Abdolhossein Sepanta, et la fille de Lor : Golnar. La structure du récit est clairement celle du Western. Comme ce sera le cas de tous les films parlant des années 30, La Fille de la tribu de Lor est tourné en Inde.
Parmi les films de cette période, on peut citer des vies de poètes comme Ferdowsi (1934) ou des adaptations littéraires comme Shirin et Farhad (1935) ou Leila et Majnoun (1935), tous trois dirigés par Abdolhossein Sepanta.
En 1937, la production iranienne s’interrompt et ne reprendra qu’en 1948 avec le premier film parlant tourné en Iran : Le Tourbillon de la vie d’Ismaël Kouchan. La majorité de la production est alors dominée par les films farsis. Quelques réalisateurs s’imposent toutefois comme Samuel Khatchikian qualifié d’« Hitchcock iranien », à qui on doit Le Carrefour des événements (1954) et la comédie Une Nuit en Enfer (1957) (voir la vidéo).
Les années 60, les origines du cinéma « Motéfavet »
Le premier film important d’auteur iranien date de 1957, année où Farrokh Ghaffari réalise Le Sud de la ville. Le film fut aussitôt interdit par le pouvoir du Shah. Selon son auteur, l’interdiction dont il fut victime a retardé de 10 ans la naissance de la Nouvelle Vague iranienne.
Toutefois, les années 60 voient l’apparition de cinéastes importants comme Forough Farrokhzad qui signe La Maison est noire (voir la vidéo) en 1963, un court métrage dans une léproserie de Tabriz. Le film est à présent reconnu comme le point de départ du Nouveau Cinéma Iranien. Il fut produit par Ebrahim Golestan, compagnon de la jeune femme, avec qui elle avait travaillé sur un autre film Le Feu comme monteuse. Golestan tournera en 1965 La Brique et le Miroir (voir la vidéo), un drame urbain influencé par le cinéma d’Antonioni : un chauffeur de taxi recueille un enfant abandonné. Sa compagne adopte l’enfant malgré ses réticences.
En 1963, Farrokh Ghaffari réalise La Nuit du Bossu, une comédie inspirée des Mille et une nuits qui rappelle aussi Mais qui a tué Harry ? d’Alfred Hitchock. A travers les tribulations d’un cadavre, le réalisateur traverse les différentes couches de la société iranienne. Autre cinéaste important, Fereydoun Rahnema réalise Kiavash à Persépolis en 1967, un film exigeant sur le passé de l’Iran. Un cinéma documentaire se met aussi en place dominé par la figure de Kamran Shirdel, auteur de Téhéran, capitale de l’Iran et Quartier de femmes qui dénoncent la misère du pays.
En 1969, Abbas Kiarostami crée le département cinématographique du Kanoun, l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes mis en place en 1964 par l’épouse du Shah.
Cette même année voit la naissance de la Nouvelle Vague iranienne avec La Vache de Dariush Mehrjui (voir la vidéo ici). Inspiré d’un conte de Gholam Hossein Sa’adi, le film relate l’identification d’un homme avec sa vache, son seul bien. Quand elle meurt, l’homme devient fou. C’est le début du « Cinéma Motefavet » qui signifie « différent » et qui apparaît comme un contre-pouvoir à la politique du Shah dont il est l’antithèse en montrant la misère et les difficultés du pays. En effet, s’il a subi certaines restrictions, notamment l’obligation de faire figurer en exergue un carton indiquant que cette histoire se situe 50 ans auparavant, le film ne fut pas interdit. Gholam Hossein Sa’adi et Dariush Mehrjui travailleront à nouveau ensemble sur Le Cycle (1974) qui aborde la question de la pauvreté et du trafic de sang.
L’autre film important de 1969 est Queysar de Massoud Kimiai. L’acteur Behrouz Vossoughi y campe un personnage de hors la loi au grand cœur (djahel) et héros tragique. La présence de lieux typiquement iraniens comme le bazar, la maison traditionnelle du Sud de Téhéran, le hammam où s’accomplit la vengeance du héros marque les esprits. Ce premier film sera suivi par Reza le motard (voir la vidéo) avec le même acteur sur une trame plus moderne.
Le cinéma iranien va ainsi connaître une décennie d’œuvres majeures où se succéderont sur les écrans des titres comme Les Mongols de Parviz Kimiavi : réflexion sur l’influence occidentale sur la culture iranienne; L’Averse de Bahram Beyzaï ou la vie d’un maître d’école dans le sud de Téhéran ; L’Harmonica (voir ici) d’Amir Naderi, fable sur le pouvoir et ses abus ; Nature morte de Sohrab Sahid Saless (voir ici) qui s’intéresse à la vie d’un couple de gardes-barrières aux gestes répétitifs dont l’impact sera considérable sur Kiarostami. Enfin, Le Passager et Le Rapport, les deux premiers longs métrages de fiction d’Abbas Kiariostami où apparaissent déjà ses grands thèmes sur l’enfance mais aussi sur l’incommunicabilité du couple qu’on retrouvera des années plus tard dans Copie conforme (2010).
Les années 80, la reprise du cinéma iranien
Avec l’éclatement de la Révolution islamique, le sort du cinéma paraît incertain. En août 1978, le cinéma Rex d’Abadan est incendié et 400 personnes y trouvent la mort. En février 1979, un discours de l’Ayatollah Khomeiny reconnaît la légitimité du cinéma en citant comme exemple La Vache de Dariush Mehrjui. Respectant les nouveaux codes en vigueur, le cinéma iranien renaît malgré la guerre Iran-Irak (1980-1988). En 1983, l’Etat met en place la Fondation Farabi et organise le premier festival du film de Fajr.
Si Les Routes froides de Massoud Jafari Jozani constitue un tournant par sa présentation au Festival de Berlin en 1985, c’est Le Coureur d’Amir Naderi qui marque durablement les esprits. Primé au Festival des 3 continents à Nantes en 1985, le film revient sur l’enfance du cinéaste et insiste sur l’importance de l’enseignement dans la formation d’un garçon des rues. Tout au long du récit, on voit le jeune Amiro réciter l’alphabet. L’action se déroule avant la révolution au bord du Golfe persique où règne une forte présence américaine. En donnant le rôle principal à un enfant et en insistant sur l’alphabétisation, Le Coureur annonce les films qui suivront (voir la vidéo).
En effet, Bashu, le petit étranger de Bahram Beyzai aborde à son tour le monde de l’enfance. Le réalisateur situe son histoire au moment même des faits, autrement dit pendant la guerre Iran-Irak, en montrant la rencontre entre un enfant du Khouzestan et une femme du Gilan interprétée par Susan Taslimi. Le film reprend plusieurs éléments de La ballade de Tara (1978) qui n’avait pu être diffusé après la révolution. On retrouve ainsi la même actrice, Susan Taslimi, avec deux enfants près de la Mer Caspienne. Comme la plupart des films du cinéaste, il s’agit d’une œuvre à la fois documentaire et métaphorique qui suit toutes les étapes de l’intégration d’un enfant dans une communauté villageoise. L’une des plus belles scènes montre Bashu malmené par les enfants du village qui moquent ses peurs et son absence de parole. Jeté à terre, il hésite entre une pierre et un livre. Il décide finalement de prendre le livre et lit à haute voix : « Nous sommes tous les enfants de l’Iran ». A ses mots, les enfants s’arrêtent. Ce sont pratiquement les seuls mots de persan prononcés dans un film où dominent le gilani et l’arabe. Commençant par des avions de guerre, le film se termine sur un envol de colombes. Tourné dans une province où la loi religieuse est moins marquée et mettant en scène des enfants, Bashu va servir de modèle à d’autre cinéaste comme Abbas Kiarostami qui l’année suivante tourne Où est la maison de mon ami ? dans la région du Gilian également. Le film sera présenté au Festival des Trois continents de Nantes. Avec cet opus, Kiarostami devient l’ambassadeur du cinéma iranien.
Si Amir Naderi, Bahram Beyzai et Abbas Kiarostami sont des cinéastes qui ont commencé leur carrière avant la révolution, d’autres s’affirment au cours de cette période comme Mohsen Makhmalbaf. C’est pour promouvoir un septième art islamique que celui-ci devient cinéaste. Au fur et à mesure des années ses positions changent, comme le souligne Jean-Michel Frodon :
« […] ses premiers films sont exécrables, bientôt ils deviennent meilleurs, puis remarquables dans un registre d’une grande invention stylistique qui s’oppose à la simplicité apparente du filmage de Kiarostami. Simultanément, le militant zélé découvre que la révolution islamique, comme les autres, ne tient pas ses promesses et dévore ses meilleurs enfants. D’artiste officiel il devient critique, puis opposant déclaré, interdit de tournage comme de distribution – mais filmant sans cesse, et montré partout en Europe »
(La Projection nationale, cinéma et nation, « Le champ médiologique », Éditions Odile Jacob, 1998, p.184).
Le parcours de Mohsen Makhmalbaf reflète la complexité de la situation des artistes iraniens. Très populaire dès ses premiers films, Makhmalbaf le devient encore plus avec Boycott, Le Camelot, La Noce des Bénis et Le Cycliste qui ouvrent sa période critique. C’est cette popularité que montre Close up d’Abbas Kiarostami.
Les années 90, la reconnaissance internationale
Second film de Kiarostami à avoir été distribué en France, Close up (voir la vidéo) marque un tournant dans la découverte du cinéma iranien. S’inspirant d’un fait divers réel, le film mène une réflexion sur le cinéma et sa place dans la société iranienne. Il s’agit de permettre la réhabilitation d’un homme victime de son amour du cinéma. En effet, Hossein Sabzian, chômeur cinéphile s’est fait passer pour Mohsen Makhmalbaf auprès d’une famille de Téhéran qui a décidé de porter plainte. Kiarostami mêle les heures du procès avec des scènes reconstituées. Vertige des apparences, il est difficile à la fin du film de distinguer la fiction de la réalité ni de savoir si Close up est l’œuvre de Kiarostami, de Makhmalbaf ou de Sabzian.
Après le tremblement de terre qui toucha la région où fut tourné Où est la maison de mon ami ?, Kiarostami décide de réaliser Et la vie continue qui montre la quête d’un père et d’un fils à la recherche des deux enfants du film précédent. Le cinéaste retournera dans la région pour Au travers des oliviers qui s’intéresse à une romance en marge d’Et la vie continue.
De son côté, Mohsen Makhmalbaf met en scène Il était une fois le cinéma (ou Nasseredine Shah, acteur de cinéma) qui revient sur l’Histoire du cinéma iranien. Le film permet de tisser un lien entre deux règnes, deux pouvoirs, et deux cinémas. Makhmalbaf s’invente une filiation à travers entre autres l’œuvre de Beyzaï et multiplie les allusions au cinéma mondial grâce à la figure de Chaplin qui se confond avec celle d’Akasbashi, le premier cinéaste iranien. Puis, le réalisateur imagine Salam Cinéma (voir la vidéo) où il repère les futurs interprètes de ses films à venir, Gabbeh et Un Instant d’innocence.
Si Kiarostami et Makhmalbaf s’imposent sur la scène internationale, d’autres cinéastes poursuivent leurs œuvres comme Dariush Mehrjui à travers une série de films consacrés à des figures féminines ou Rakhshan Bani-Etemad, la première cinéaste iranienne à se faire reconnaître après la Révolution, ouvrant la voie à beaucoup d’autres.
En effet, l’une des singularités de l’Iran postrévolutionnaire est le nombre de femmes cinéastes. Outre Bani-Etemad, on peut citer Samira Makhmalbaf, Tamineh Milani, Niki Karimi ou Mania Akbari. Une nouvelle génération d’acteurs et d’actrices s’affirment également avec Leila Hatami, Golshifteh Farahani,Taraneh Alidousti.
Les années 2000, une nouvelle génération
Un changement important s’amorce à partir des années 2000 comme le montre Le Cercle de Jafar Panahi qui marque la naissance d’un genre nouveau dans le cinéma iranien, celui des films de femmes prenant la suite des films d’enfants. Panahi avait commencé comme assistant de Kiarostami sur Au travers des Oliviers avant de réaliser son premier long métrage, Le Ballon Blanc, en 1995. Le film s’inscrivait dans la tradition des films de Kiarostami mais avec deux particularités : il est tourné à Téhéran et le héros est une petite fille. Son second long métrage, Le Miroir, marque une rupture et une critique des films sur l’enfance.
On retrouve dans Le Cercle la notion de temps réel en suivant le destin de 6 femmes. De l’accouchement à l’emprisonnement en passant par l’avortement et l’abandon, le cinéaste aborde des thèmes jusqu’ici absent du cinéma iranien en jouant sur la figure du cercle qui se referme à l’image d’une prison à la fois intérieur et extérieur.
Son film suivant, Sang et or, renouvelle le genre du film policier en Iran. Opposant les quartiers riches du Nord à ceux populaires du Sud, il suit Hossein, livreur de pizzas la nuit et pickpocket le jour. C’est l’une des œuvres les plus radicales du cinéaste.
Cette nouvelle donne du cinéma iranien est renforcée par l’apparition d’un cinéma de la diaspora symbolisé parPersepolis (2006) de Marjane Satrapi. Le film utilise aussi bien une animation traditionnelle que des images inspirées des miniatures persanes, du théâtre de marionnettes ou du photojournalisme. La dessinatrice réhabilite la révolution tout en condamnant le régime qui a suivi. L’œuvre a déplu autant aux Royalistes qu’à la République islamique. Le film marque une date en donnant à voir l’exil. Inspiré d’une autre de ses bandes dessinées, Poulet aux prunes (2010) se situe dans les années 50 et met en scène des acteurs réels (Mathieu Amalric, Golshifteh Farahani, Isabella Rossellini). Il s’agit cette fois de l’exil intérieur des intellectuels et des artistes iraniens sous le Shah. Comme Persepolis, le film se termine sur le mot « Iran ».
On citera également parmi les représentant de ce cinéma iranien de la diaspora : Pour un instant, la liberté (2009) d’Arash T. Riahi, œuvre chorale qui aborde la situation de réfugiés politiques en attente de leur visa pour l’Europe ainsi que Women without men (2009) de Shirin Neshat inspiré du roman de Sharhnoush Parsipour dont l’action se situe durant le coup d’État de la CIA contre le gouvernement du Dr. Mossadegh en août 1953.
2009, Une Séparation et après ?
Téhéran est au cœur de plusieurs films de ces dernières années. Ainsi le documentaire Tehran has no more pomegranates (2006) de Massoud Bakhshi (voir la vidéo), ou la fiction Lonely Tunes of Tehran (2008) de Saman Salour. Le phénomène s’accentue en 2009 avec Les Chats persans de Bahman Ghobadi, My Tehran for sale de Granaz Moussavi, Téhéran de Nader T. Homayoun, Green Days d’Hana Makhmalbaf ou The Hunter de Rafi Pitts.
Les deux derniers films ont été réalisés au moment des élections présidentielles dont ils rendent compte. Tourné quelques mois auparavant, Les Chats persans s’intéresse à la scène musicale clandestine. Le film est présenté à Cannes en mai et annonce ce qui allait se passer en juin.
L’Iran connu en effet les plus importantes manifestations de son histoire. En filmant les événements, les citoyens permirent la naissance du Mouvement vert à l’origine de la première « révolution Facebook ». Dans un entretien accordé à la chaîne « Voice of America », Mohsen Makhmalbaf évoquera une nouvelle génération de cinéastes à travers tous ces vidéastes amateurs.
C’est sur le nom de Panahi que se concentrera le mouvement de contestation durant l’année 2010. En décembre 2010, le cinéaste est condamné à une peine de six ans d’emprisonnement suivie de 20 ans d’interdiction de faire des films, donner des interviews ou quitter l’Iran. Après avoir fait appel, il réalise Ceci n’est pas un film montré au Festival de Cannes en 2011. Passible de la même peine, Mohammad Rasoulof tourne quant à lui Au revoir, présenté également à Cannes dans la sélection « Un certain regard » où il remporte le Prix du Jury.
Mais l’année 2011 fut surtout celle d’Une Séparation d’Asghar Farhadi, le plus grand succès du cinéma iranien : Ours d’or à Berlin en février 2011 et Oscar du meilleur film étranger à Hollywood en février 2012. Sans être directement politique, il s’agit d’une œuvre sociale sur un pays en panne d’utopie. Le cinéaste met en scène deux couples, deux classes sociales, deux enfants et montrent tout ce qui les sépare et les réunit. La caméra joue un rôle de témoin. Aucun personnage n’est désigné comme seul responsable d’une situation. Il s’agit de montrer les torts mais aussi les raisons de chacun. On peut ainsi parler d’une révolution intellectuelle à l’œuvre en Iran à travers notamment le cinéma.
Au terme de ce parcours, il apparaît que le cinéma iranien s’écrit de plus en plus au pluriel. Voilà pourquoi nous parlerons d’un « Iran ciné panorama ».
Bamchade Pourvali